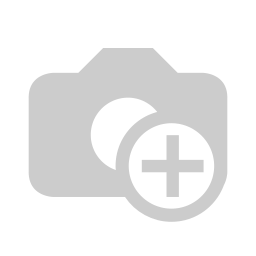
Expertise Comptable
Tenue, révision, bilan 45 j.
Sommaire
La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du CDI, négocié entre l’employeur et le salarié. Elle se distingue de la démission (initiative du salarié, sans indemnité) et du licenciement (initiative de l’employeur, cause réelle et sérieuse exigée). Elle n’implique ni griefs ni fautes et suppose un consentement libre et éclairé des deux parties. Elle se distingue aussi de la rupture conventionnelle collective, qui relève d’un accord collectif spécifique. L’outil convient lorsqu’une séparation apaisée sert les intérêts des deux parties, avec une indemnité au moins égale au minimum légal ou au plancher conventionnel s’il est plus favorable.
La rupture conventionnelle est réservée aux CDI. Un CDD se termine à son terme ou par rupture anticipée dans des cas limités ; un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation suit d’autres règles. Un CDD n’est donc pas éligible à la rupture conventionnelle « classique ». La relation de travail doit se poursuivre au moment de la négociation ; l’outil n’est pas destiné à « régulariser » a posteriori une sortie déjà intervenue.
Certains contextes exigent une vigilance accrue. Un salarié protégé (délégué syndical, élu du CSE, candidat protégé, etc.) ne passe pas par une simple homologation : la rupture nécessite une autorisation de l’inspection du travail. L’outil reste possible mais le contrôle est renforcé. En cas d’inaptitude déclarée par la médecine du travail, la rupture conventionnelle est admise à condition que la volonté du salarié soit libre et que l’employeur n’utilise pas cet outil pour éviter ses obligations légales de reclassement lorsqu’elles existent. Pendant un arrêt de travail (maladie, accident), la négociation est possible en droit, mais les juges scrutent la liberté du consentement et la réalité de l’échange. L’usage prudent recommande de formaliser les entretiens avec soin, de laisser des délais et de respecter la confidentialité.
Le processus suit un fil conducteur simple et protecteur. Les parties échangent d’abord sur le principe, le montant de l’indemnité, la date de fin de contrat envisagée et la situation des congés payés. Elles tiennent au moins un entretien dédié. Elles renseignent ensuite le formulaire prévu par la loi, y indiquent les montants, la date prévisionnelle de rupture et les coordonnées. Les deux signent ; c’est le point de départ du délai de rétractation.
À l’issue de ce délai, si personne ne s’est rétracté, l’employeur transmet la demande d’homologation à l’autorité administrative compétente. Cette étape déclenche le délai d’instruction. Sans réponse dans le délai légal, l’homologation est tacite. La rupture ne peut intervenir qu’après l’homologation explicite ou tacite. Les documents de fin de contrat sont remis à la date convenue, les soldes sont versés et les attestations de fin de contrat sont établies.
Dans les entreprises structurées, un calendrier interne encadre ces étapes pour éviter les précipitations : réunion d’ouverture, validation RH et paie, vérification de la base de calcul, contrôle juridique, signature, rétractation, envoi de la demande, suivi de l’homologation, préparation du solde et remise des documents.
Le délai de rétractation est de 15 jours calendaires à compter du lendemain de la signature de la convention. Chaque partie peut se rétracter sans motif par écrit. Le délai se calcule en jours calendaires : week-ends et jours fériés sont comptés. La rétractation dans les temps met fin au processus ; la relation de travail se poursuit.
Après le délai de rétractation, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables pour homologuer la convention. L’absence de réponse dans ce délai vaut homologation tacite. Le contrôle porte sur le respect des délais, le montant de l’indemnité (au moins égal au minimum légal ou conventionnel plus favorable) et la liberté du consentement. En cas de refus d’homologation, la convention est nulle et la relation se poursuit, sauf à reprendre un nouveau cycle de négociation.
Les parties fixent librement la date de fin du contrat, mais cette date ne peut pas être antérieure au lendemain de l’homologation explicite ou tacite. Il n’existe pas de préavis légal comme en licenciement ou en démission ; la relation se poursuit jusqu’au jour fixé par la convention homologuée. Les congés payés acquis et non pris sont indemnisés au solde de tout compte. Les clauses particulières (non-concurrence, restitution de matériel, confidentialité) sont rappelées et exécutées comme dans toute fin de CDI.
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l’indemnité conventionnelle prévue par la branche. La formule légale s’applique dès 8 mois d’ancienneté ininterrompue :
L’indemnité légale =
1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années,
puis 1/3 de mois par année au-delà de 10 ans.
Les années incomplètes se calculent au prorata du temps accompli. La convention collective peut prévoir un plancher supérieur, des majorations par tranche d’ancienneté ou une base de calcul plus favorable. Dans ce cas, on applique la règle la plus favorable au salarié.
Des spécificités existent pour certaines catégories (cadres, assimilés, conventions de la métallurgie, du commerce, des cabinets d’avocats, etc.). En pratique, on compare systématiquement l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle et l’on retient la plus élevée. La négociation peut porter l’indemnité au-delà de ce plancher, sous réserve des règles fiscales et sociales vues plus loin.
La base de calcul s’établit, au choix le plus favorable, sur :
– la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la notification ; ou
– la moyenne des 3 derniers mois.
Dans ce dernier cas, on reconstitue la rémunération en y intégrant la part annuelle des primes qui, par nature, n’ont pas été versées sur seulement 3 mois (primes de performance, 13ᵉ mois au prorata, primes de vacances, variables). Les éléments exclus du salaire de référence sont les remboursements de frais et les sommes n’ayant pas la nature de salaire. Les heures supplémentaires régulières peuvent entrer dans la base lorsqu’elles caractérisent un complément de rémunération habituel. En cas d’absence sur la période de référence (maladie, congé), on applique les règles de reconstitution usuelles pour éviter un salaire de référence artificiellement minoré.
Le régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle combine trois logiques : planchers d’exonération, plafonds et contributions spécifiques.
Côté employeur, la rupture conventionnelle supporte en 2025 une contribution patronale spécifique de 30 % sur l’indemnité versée (hors cas particuliers assimilés à la retraite). Cette contribution remplace les dispositifs antérieurs moins élevés ; elle a pour objet d’aligner le coût de sortie sur d’autres modes de rupture. Elle s’ajoute aux autres charges éventuelles si la part indemnitaire dépasse les seuils d’exonération sociale.
Côté salarié, l’indemnité bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite du montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement. La fraction excédentaire devient assujettie aux cotisations sociales de droit commun au-delà de plafonds fixés par la réglementation. L’indemnité est en principe soumise à CSG-CRDS sur une partie de son montant, selon les règles en vigueur. Sur le plan fiscal, une part de l’indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu dans des limites encadrées ; la fraction qui dépasse ces limites est imposable. Comme les barèmes peuvent évoluer, la pratique Nexco consiste à simuler la répartition entre part exonérée et part imposable avant d’arrêter le montant de la convention, afin d’éviter les surprises en net perçu par le salarié ou en coût global pour l’employeur.
Lorsque l’indemnité dépasse largement le minimum, l’entreprise anticipe l’impact sur le différé d’indemnisation chômage (voir plus bas) et sur la masse salariale sociale et fiscale de la période.
La rupture conventionnelle permet en principe l’accès à l’allocation de retour à l’emploi (ARE), sous réserve des conditions générales : activité salariée antérieure suffisante, inscription auprès de l’opérateur public de l’emploi, recherche active, et absence de motif d’exclusion particulier. Le salarié remet l’attestation de fin de contrat, s’inscrit et dépose ses justificatifs. L’ouverture des droits dépend du parcours de l’intéressé, de son salaire journalier de référence et de la durée d’affiliation récente.
Trois éléments retardent le versement de l’ARE. D’abord, un délai d’attente de 7 jours s’applique de manière standard. Ensuite, un différé congés payés est calculé lorsque des indemnités compensatrices de congés sont versées ; il reporte le début d’indemnisation d’un nombre de jours correspondant. Enfin, un différé spécifique est calculé sur la part d’indemnité supra-légale, selon une formule fixée par la réglementation et plafonné. Ce dernier diffère ne s’applique pas à la part correspondant strictement au minimum légal ou conventionnel.
Pour éviter qu’un salarié ne surestime son net disponible à la sortie, la bonne pratique consiste à simuler l’ARE, le début effectif de paiement après différés et le revenu de transition du foyer. Les entreprises bienveillantes partagent parfois un mémo de recalage pour éviter les bleus à l’atterrissage.
Pour un salarié protégé, la rupture conventionnelle requiert l’autorisation de l’inspection du travail et non une homologation simple. La procédure s’allonge, la motivation est examinée et la liberté du consentement est particulièrement contrôlée. Les règles relatives aux mandats et à la période de protection doivent être scrupuleusement vérifiées.
En cas d’inaptitude prononcée par la médecine du travail, la rupture conventionnelle reste possible mais suppose des échanges clairs sur l’impossibilité ou l’échec du reclassement, sans pression. La pratique exige de documenter ces étapes pour prévenir tout risque de nullité. La faute grave ou lourde ne se traite pas via une rupture conventionnelle ; si un processus disciplinaire est engagé, il est incohérent de négocier simultanément une RC qui suppose un consentement apaisé.
Pendant un arrêt maladie, rien n’interdit en soi la négociation, mais l’entreprise sécurise la liberté du consentement : rendez-vous espacés, temps de réflexion étendu, possibilité de venir accompagné, puis respects des délais intégraux avant signature et homologation.
La première erreur consiste à calendrier trop serré. Une date de fin trop proche de la signature expose à un refus d’homologation si le délai de rétractation ou d’instruction n’est pas respecté. La seconde erreur est de fixer une indemnité en dessous du minimum légal ou conventionnel ; le dossier sera refusé. La troisième erreur est de négliger la base de calcul : primes, variables, heures supplémentaires habituelles. Une base mal reconstituée entraîne des contests et fragilise l’homologation.
Côté salarié, l’erreur la plus fréquente est d’ignorer l’impact des différés sur la trésorerie des premiers mois. Autre erreur : démissionner après une RC avortée, sans alternative, alors qu’un licenciement pour motif personnel aurait peut-être été préférable selon le contexte. Des clauses mal gérées (non-concurrence, restitution de matériel, confidentialité) créent aussi des litiges inutiles. La prudence commande de relire la convention, de simuler net perçu et ARE, et de vérifier les clauses post-contractuelles.
D’abord, qualifiez le contexte : performance, projet du salarié, risques, image. Si la RC est pertinente, cadrez le périmètre de la négociation : date cible, congés, matériel, clause de non-concurrence, accompagnement éventuel. Calculez l’indemnité plancher (légal vs conventionnel), puis simulez plusieurs hypothèses d’indemnité négociée en intégrant l’impact social/fiscal et le coût employeur (contribution spécifique). Établissez le salaire de référence avec rigueur (12 mois, 3 mois reconstitués, variables). Planifiez les entretiens et la signature, laissez du temps pour la réflexion, puis déposez la demande d’homologation et suivez l’instruction. Une fois l’homologation acquise, préparez le solde, les documents de fin de contrat et l’attestation d’emploi, puis archivez la convention et la preuve d’homologation au dossier social.
Non. La rupture conventionnelle « classique » ne concerne que les CDI. Un CDD obéit à ses propres cas de rupture.
Oui, mais la rupture doit être autorisée par l’inspection du travail. Ce n’est pas une simple homologation.
Non. Les parties fixent librement la date de fin du contrat, qui doit intervenir après l’homologation explicite ou tacite.
Sur la base du salaire de référence : 1/4 de mois par année pour les 10 premières années, puis 1/3 au-delà, au prorata pour les fractions d’année.
Oui, lorsqu’elles sont habituelles. On choisit la moyenne 12 mois ou 3 mois reconstitués, selon ce qui est plus favorable.
Oui, sous conditions d’affiliation et d’inscription. Des différés s’appliquent (7 jours, congés payés, différé spécifique sur la part supra-légale).
La contribution patronale spécifique de 30 % sur l’indemnité s’ajoute au coût. D’où l’intérêt de simuler le coût complet avant de signer.
En droit, c’est possible, mais la vigilance sur la liberté du consentement est maximale. On formalise et on espace les étapes.
La clause continue de produire ses effets si elle est valide et indemnisée selon ses propres règles. Il est utile de la revoir lors de la négociation.
La convention est nulle ; le contrat continue. Les parties peuvent renégocier ou envisager un autre mode de rupture selon le contexte.
— Code du travail : articles L1237-11 à L1237-16 (rupture conventionnelle du CDI), L1234-9 et R1234-2 (indemnité légale de licenciement), L2411-1 et suivants (salariés protégés).
— Procédure : entretien(s) préalable(s), délai de rétractation 15 jours calendaires, homologation 15 jours ouvrables, homologation tacite en l’absence de réponse.
— Indemnité : plancher légal ou conventionnel si plus favorable, pro rata des années incomplètes, salaire de référence au choix (12 ou 3 mois reconstitués).
— Régime social/fiscal 2025 : contribution patronale spécifique 30 % sur l’indemnité ; règles d’exonération partielle de cotisations et d’impôt dans des limites encadrées.
— Chômage : ARE accessible sous conditions ; délai d’attente 7 jours, différé congés payés, différé spécifique sur l’indemnité supra-légale (plafonné).
Chez Nexco, nous cadronnons vos ruptures conventionnelles de bout en bout : simulation indemnitaire légale, conventionnelle et négociée ; calcul du coût employeur réel (contribution spécifique incluse) ; reconstitution du salaire de référence ; sécurisation des délais et du dossier d’homologation ; préparation du solde et des documents de fin de contrat. Notre approche est humaine, digitale et sur-mesure. Parlez-nous de votre contexte, nous vous remettons un mémo décision en 24 heures ouvrées.
Chez Nexco, nous nous engageons à offrir un service comptable de proximité, alliant humanité, expertise et outils digitaux.
Basés à Paris, nous utilisons les derniers outils (digitalisation, IA, ...) pour garantir une comptabilité fluide et transparente. Notre équipe d'experts-comptables est dédiée à fournir un accompagnement personnalisé, en apportant des conseils avisés pour optimiser la gestion de votre entreprise.
Explorez nos services spécialisés et découvrez comment nous pouvons vous aider :
Avec Nexco, bénéficiez d'une expertise comptable adaptée à votre secteur et d'un soutien continu pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets.
Nexco Expert-Comptable
29 rue du Colisée, 75008 Paris
01 59 13 35 79 • Ouvert 9h–20h
Itinéraire Google Maps
SIRET : 894279652 • Membre de l’Ordre des Experts-Comptables
Comptabilité • Audit • Conseil financier digital
RDV gratuit